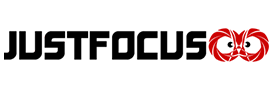Signé sur le prestigieux label RCA dès leur deuxième album, le groupe britannique Everything Everything revient pour livrer l’un des disques les plus rafraîchissants de l’été. Une sorte d’apothéose de la mixture Pop / Art-rock, que le quatuor se plaît à travailler depuis une petite décennie.
La formation portée par Jonathan Higgs se devait de manigancer quelque chose de grand. Deux ans après le très oubliable Get to Heaven, le groupe avait grand besoin renouer avec l’imprévisibilité qui le caractérise depuis son premier effort musical. Les compteurs sont remis à zéro, et c’est un euphémisme. A Fever Dream se pose en maillon indispensable de la chaîne Everything Everything.
A Fever Dream, c’est avant tout une science de l’agencement. On pardonne volontiers au groupe d’atteindre le point Godwin dès le titre introductif de leur quatrième album. Night Of The Long Knives assène une claque Pop sans avoir la décence de nous préparer l’épiderme. Le timbre suraigu de Jonathan Higgs n’a rien perdu de sa puissance, et oscille en permanence entre le petit côté irritant des envolées lyriques et la mise en beauté de paroles majestueusement écrites.
Et puisque la voix de son leader est l’un de ses plus gros atouts, le groupe l’use ; l’expérimente. Instruments les plus virtuoses de la formation, les notes qui sortent de la bouche de Jonathan Higgs officient comme autant de chefs d’orchestres chargés de guider cordes et tambours. Ce ne sont pas les refrains de Can’t Do et Desire (les deux singles de l’album) qui contrediront ce constat. Un gimmick, donc, qui peut également faire fuir les moins sensibles aux voix haut-perchées.
Fièvre estivale
Du reste, A Fever Dream corrige immanquablement les erreurs de son prédécesseur. Balourd et foutraque, Get to Heaven avait néanmoins pour lui une science de l’inconstance et de l’expérimentation. Le quatrième album de EvEv en est l’antithèse. Formellement cohérent, les titres trouvent leur parenté dans ce qu’ils ont de surprenants et d’irrémédiablement instantanés. On est face à une Pop travaillée, complexe. Rien n’est gratuit chez le quatuor britannique. Et s’ils disent s’être inspirés de grands noms tels que Radiohead, les Beatles et Nirvana pour la composition de cet album, on n’en retient que l’identité musicale forte que le groupe commence à se forger.
Notamment grâce à des morceaux à la dualité bienvenue, à l’instar de Big Game. Le fracas de la percussion de son introduction ne saurait préfigurer de la sensibilité de son refrain. Celui-ci, encore, ne saurait augurer de l’explosion du dernier tiers de la chanson. Good Shot, Good Soldier en est également un criant exemple, avec son chorus dont on souhaiterait qu’il ne s’arrête jamais.
Album solide et bien construit, certaines pommes tombent néanmoins trop loin de l’arbre. Run The Numbers manque sa cible, la faute à un refrain criard qui devrait servir à la formation de référentiel-mal-de-crâne. Un déchaînement de Rock, qui s’il n’est pas de mauvaise volonté, trouve difficilement sa place au milieu de morceaux à la subtilité plus avérée. Car si Everything Everything se vautre quand il bombe le torse, le groupe excelle lorsqu’il s’agit de verser son cœur sur du papier à musique, comme en témoigne Put Me Together.
On ne trouvera pas de fausse note dans le dernier quart de l’album. L’épatant titre éponyme nous apprend que le groupe est capable de nous foutre des frissons en faisant de la House. Ivory Tower nous tétanise avec son refrain scandé à tue-tête. New Deep, interlude, dévoile des compétences de sound design que l’on ne soupçonnait pas chez le quatuor. Science de l’agencement, écrivais-je plus haut : White Whale en est le dernier exemple, et vient refermer avec une orchestration fameuse ce qui finira sans doute par devenir le meilleur album de Everything Everything.
Pierre Crochart